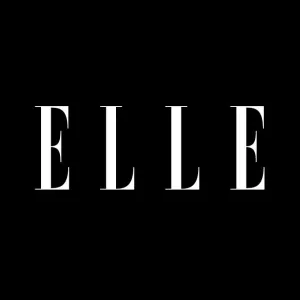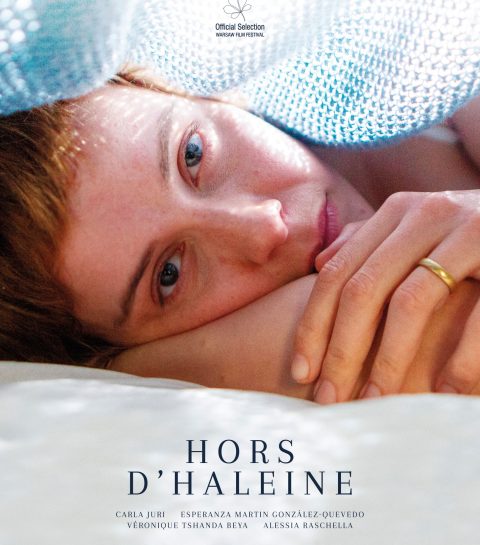Elles sont galeristes, avocates, entrepreneuses ou photographes. Elles vivent au Luxembourg, mais leur regard traverse les frontières. Et leur passion pour l’art va bien au-delà du goût ou du statut social ; elle est une conviction.
Cette génération de femmes collectionneuses se distingue par l’engagement qui sous-tend leurs choix. Social, local ou personnel : collectionner, pour elles, est affirmer une posture au monde. ELLE Luxembourg est allé à leur rencontre.
Héritages invisibles, légitimité retrouvée
Dans l’imaginaire collectif, collectionner de l’art suppose un capital financier et culturel, et nombreuses sont les femmes qui reconnaissent avoir ressenti un sentiment d’imposture au moment d’acquérir leur première œuvre. « Beaucoup de jeunes amateurs d’art pensent à tort qu’il faut une expertise ou des moyens considérables pour collectionner, alors qu’il est possible de commencer avec un budget raisonnable », confie Éléonore Moreau-Gentien, avocate à la cour et cofondatrice du Young Collectors Club (YCC). Le langage souvent hermétique du marché de l’art et ses codes sociaux n’aident pas.
L’expérience de Carine Smets, fondatrice de SMETS, illustre un autre parcours : « La collection s’est construite par hasard, au fil des foires et des rencontres artistiques, et surtout pas seule. C’est une aventure de couple, une passion, qui a abouti à la collection actuelle. » Pas de stratégie, pas de volonté d’« oser », mais une aventure à deux née d’un cheminement organique.
« C’est une aventure de couple, une passion, qui a abouti à la collection actuelle. » — Carine Smets
Collectionner de l’art a longtemps été un territoire dominé par la puissance financière, les réseaux mondains et la reconnaissance institutionnelle. Dans ce paysage, les femmes collectionneuses restaient dans l’ombre : présentes mais rarement visibles, effacées par l’histoire ou cantonnées à la sphère privée. Désormais, la donne change.
Florence Reckinger-Taddeï a elle aussi commencé à composer une collection avec son mari. Mais elle insiste : cette dynamique ne tient pas seulement au couple, elle repose avant tout sur une passion commune, où chacun garde son regard. « Je ne considère pas que nous collectionnons en couple. Nous achetons des œuvres ensemble, mais nous faisons également des choix seuls, l’un et l’autre. Parfois, ils sont surprenants, mais cela nous donne de la matière pour ouvrir le dialogue. »
De l’intime au collectif
Contrairement à la logique patrimoniale ou spéculative qui a longtemps marqué les grandes collections, beaucoup de femmes font un pas de côté et ancrent leur démarche dans un espace plus intime. La photographe Émilie Rolin Jacquemyns collectionne dans l’idée de transmettre à ses enfants. Son ensemble s’apparente à une cartographie sensible d’histoires invisibilisées et de trajectoires en exil. « Ce sont des fragments d’expériences humaines qui, mis ensemble, construisent une autre manière de voir le monde », explique-t-elle.
Pour Florence Reckinger-Taddeï, collectionner est indissociable du quotidien familial. Les œuvres habitent la maison, rythment les déménagements — « la première chose que nous faisons lorsque nous emménageons est d’accrocher nos œuvres », s’amuse-t-elle — et nourrissent les discussions avec ses enfants. « Je n’ai jamais eu de stratégie. Les œuvres font partie de mon quotidien. » L’œuvre devient un membre de la famille, ou du moins un miroir intime.
« Une collection privée peut jouer un rôle public » — Florence Reckinger-Taddeï
Mais cet intime déborde rapidement sur le collectif. Soutenir un artiste émergent, contribuer à la vitalité d’une scène locale, transmettre une sensibilité : autant de gestes qui dépassent le cercle privé. « Une collection privée peut jouer un rôle public », insiste Florence Reckinger-Taddeï. Dans un pays où les institutions muséales sont relativement jeunes et le mécénat encore en construction, cette articulation entre personnel et collectif joue un rôle décisif.
Collectionner pour s’engager
Pour beaucoup de femmes interrogées, choisir une œuvre revient à choisir un point de vue sur le monde. « Collectionner, c’est soutenir les autres, et s’entourer d’œuvres qui font vibrer, réfléchir, revenir à soi », explique Émilie Rolin Jacquemyns.
Audrey Bossuyt, cofondatrice de la galerie Zidoun-Bossuyt, a très tôt constitué une collection tournée vers les artistes afro-américains. « Leur travail parlait d’identité, d’histoire, de représentations », dit-elle. Un geste audacieux à l’époque, quand peu de collectionneurs s’y intéressaient. Pour elle, acheter n’est jamais neutre : c’est soutenir une voix marginalisée, participer à un rééquilibrage du récit artistique.
Clémence Boisanté, chez Ceysson & Bénétière, évoque quant à elle une autre forme d’engagement : chercher des artistes qui déplacent le regard sans nécessairement provoquer. « J’aime ceux qui suscitent des nuances plutôt que des évidences », explique-t-elle. Un geste moins frontal, mais tout aussi politique.
Florence Reckinger-Taddeï explique également que son engagement va vers des artistes encore en marge du marché, ou à un moment donné dans le creux de la vague. « Soutenir un artiste en début de parcours, ou lorsqu’il n’est plus dans les radars, c’est prolonger ses convictions. » Acheter une œuvre devient alors plus qu’un choix esthétique : c’est une façon de prendre position, d’affirmer qu’un autre récit reste possible.
Carine Smets insiste sur l’importance du regard porté par les artistes : « Ce sont les artistes qui portent un regard sur le monde. Collectionner, c’est s’approprier un fragment de leur vision. »
Le Luxembourg comme laboratoire
C’est un fait, le Grand-Duché offre un terrain singulier. Petit pays, riche d’une scène cosmopolite, il combine proximité et ouverture. La création de Luxembourg Art Week il y a onze ans a donné un élan décisif à cette vitalité, offrant un espace de rencontres entre collectionneurs, artistes et galeries.
« On assiste à une redéfinition du geste de collectionner, portée notamment par les femmes », observe Mélanie de Jamblinne de Meux, qui dirigera Luxembourg Art Week en 2025 après en avoir été la directrice adjointe. Pour elle, la force de ces collectionneuses réside dans une approche moins verticale, plus dialogique : « Elles ne cherchent pas la reconnaissance, elles cherchent une résonance. »
Les galeries locales jouent quant à elles un rôle d’accélérateur : Zidoun-Bossuyt ou Ceysson & Bénétière inscrivent la scène luxembourgeoise dans les circuits internationaux, tandis que des figures comme Alex Reding ou Martine Schneider-Speller ont ancré le pays dans une histoire artistique plus large. Pour Carine Smets, il s’agit de « faire circuler les œuvres, les idées ».
« Donner une accessibilité aux artistes, dans un univers où beaucoup se sentent encore intimidés. » — Éléonore Moreau
De son côté, le Young Collectors Club illustre cette dynamique : visites privées, ateliers, rencontres, médiation. Son ambition est de créer une « bulle de bienveillance » qui rend l’art accessible. « On peut poser toutes les questions », dit Éléonore Moreau-Gentien. Une accessibilité précieuse dans un univers où beaucoup se sentent intimidés.
Raconter, plutôt qu’accumuler
Carine Smets précise que la différence entre hommes et femmes collectionneurs tient moins à la perception qu’au contexte : « Les hommes ont souvent disposé de moyens financiers plus importants, ce qui leur a permis de constituer de grandes collections. Cela a parfois donné l’image d’une accumulation, mais il faut reconnaître leur mérite d’avoir pressenti l’émergence de nouveaux langages artistiques, de Basquiat à Keith Haring, en passant par Andy Warhol. Plus tôt déjà, au XIXe siècle, certains avaient soutenu les impressionnistes au moment même où leurs œuvres étaient rejetées par les salons officiels. »
Pour elle, ce n’est pas une question de genre, mais de ressources et d’opportunités. Reste que dans un monde patriarcal où les femmes ont toujours été moins rémunérées à poste équivalent, le genre conditionne l’accès à ces ressources — expliquant pourquoi l’histoire retient davantage de grands collectionneurs que de grandes collectionneuses.
« Une collection pose les jalons de moments de vie », explique Clémence Boisanté. La collection devient un autoportrait en fragments, mêlant engagement, mémoire et transmission. Loin d’un patrimoine figé, elle est une matière vivante qui accompagne les métamorphoses.
Collectionner pour demain
Ainsi, ce mouvement dessine peut-être l’avenir de la collection : un geste moins vertical, moins patrimonial, plus sensible, plus dialogique, peut-être plus responsable. Dans un monde où l’art est parfois réduit à sa valeur marchande, ces femmes rappellent que collectionner, c’est prêter attention à une voix, une scène, un récit.
« Une collection pose les jalons de moments de vie. » — Clémence Boisanté
De fait, au Luxembourg, ce basculement prend racine dans une scène jeune, portée par la curiosité, la proximité et l’audace. De quoi transformer les collections privées en catalyseurs publics, capables de nourrir une culture plus inclusive. Collectionner, pour elles, n’est ni un signe extérieur de richesse ni un jeu de pouvoir. C’est une manière de se situer dans le monde. Et d’y laisser sa trace.
À lire également
De Mains de Maîtres : que nous réserve l’édition 2025 ?
Vever, l’art de faire renaître une maison joaillière oubliée
Design au Luxembourg : une scène structurée et vivante