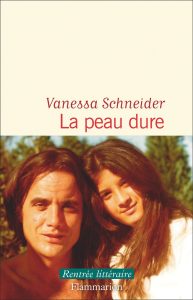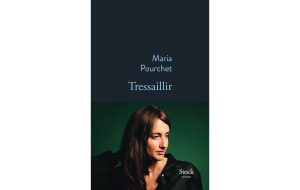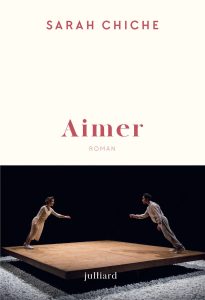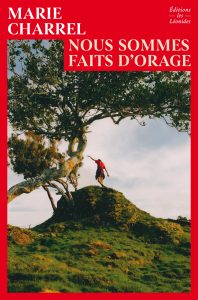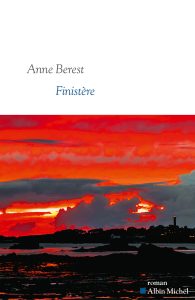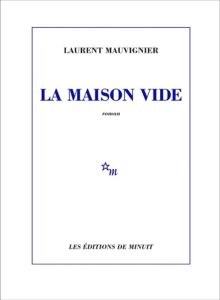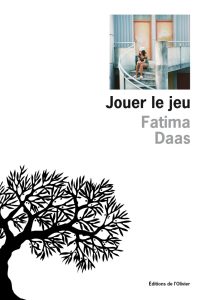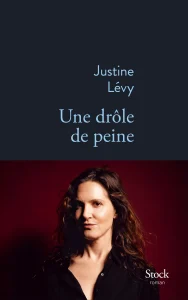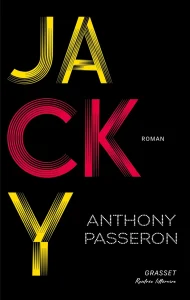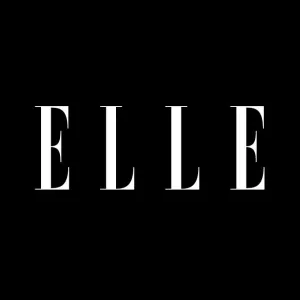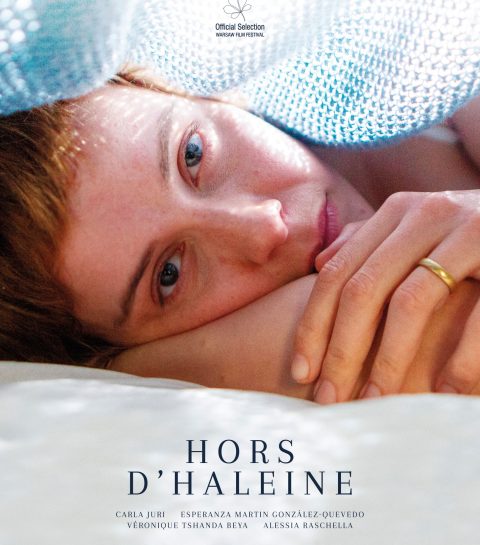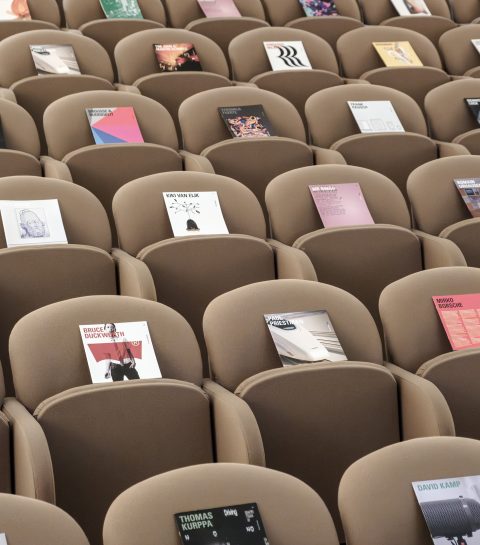484 nouveaux ouvrages s’installent sur les tables de nos librairies préférées cet automne. Derrière ce vertige de titres, un fil rouge persiste, indéfectible : celui de la famille. Ces liens qu’on noue et qu’on défait, ces liens dont on hérite malgré soi. Ces êtres qu’on aime follement ou qu’on fuit, ces absents qui continuent de peser, ces pères, ces mères, ces enfants qui nous hantent autant qu’ils nous façonnent.
Dans cette rentrée littéraire, la filiation se décline sous toutes ses coutures : tendresse et tyrannie, mémoire et oubli, héritage et rébellion. Dix romans, dix voix singulières qui nous disent que l’amour et la douleur, la transmission et le manque sont les matières premières de toute vie – et de toute littérature. Les dix coups de cœur ELLE Luxembourg.
La Peau dure, Vanessa Schneider (Flammarion)
Alors qu’elle vient d’enterrer son père, Michel Schneider, Vanessa Schneider découvre une pochette remplie de documents (dont un roman de Sandor Marai) à son nom, comme une invitation à revenir sur le lien complexe qui les unissait, mais aussi sur ce qu’il a vécu. « Tu es forte », lui adresse-t-il d’outre-tombe.
Intellectuel brillant et reconnu en société, ce père était un tyran domestique, englué dans son temps et ses idées bien arrêtées ; pourquoi changer ? Au fil des pages, on découvre que, comme trop souvent, avant d’être le bourreau, lui aussi a été la victime. Un gosse blessé devenu adulte comme il a pu et qui a tenté de faire – sûrement – du mieux qu’il le pouvait avec ce qu’il avait entre ses mains.
Vanessa Schneider ne l’épargne pas pour autant, et brosse de lui un portrait corrosif, teinté d’ironie, porté bien sûr par sa langue superbe. Un hommage ambivalent qui dit toutefois l’amour et l’admiration et questionne à bien des égards la filiation et pourquoi on aime inconditionnellement ses parents.
Tressaillir, Maria Pourchet (Stock)
C’est l’histoire d’une dispute absurde. De ces guéguerres – ô combien banales – du quotidien qui usent les couples et détruisent les familles. Alors Michelle fuit. Sans se poser de question, sans plan, même si un amant traîne dans le paysage. Deux années de déracinement, de mémoire qui remonte, de corps qui tressaillent entre repos et effroi, loin de celle qu’elle était. Celle qu’elle ne veut plus être. Tressaillir est le récit d’une errance intime, portée par cette écriture nerveuse, palpable et sensuelle, sibylline parfois, tortueuse souvent. Normal, elle suit les méandres de l’esprit des gens qui doutent, de ceux qui se perdent, de celles qui ne savent plus comment avancer. Résolument, il faudrait tout lire de Maria Pourchet. Aucune autre autrice contemporaine ne sait dépeindre avec plus de talent et de vérité le lien amoureux, le vrai, en dépit de toutes les injonctions qui lui collent à la peau. Michelle est cette femme qui, tant bien que mal, va s’ériger contre, va résister. Une plongée au cœur de l’intime et de ses ruines.
Aimer, Sarah Chiche (Julliard)
Ceci n’est pas un roman d’amour, quand bien même le titre semble l’indiquer. Ceci n’est pas une bluette de vacances non plus. Ce roman raconte l’amour.
Quel sort pend au nez de nos amours enfantines ? Margaux et Alexis se rencontrent près de Lausanne, alors qu’ils n’ont que neuf ans. Le père d’Alexis sauve la camarade de son fils d’une mort certaine ; un lien tacite unit alors ces deux enfants que tout oppose. Quand Alexis grandit et s’épanouit dans une famille stable et aimante, Margaux suit sa mère et son amant en Suisse : qui sait ce qu’il se passe derrière les volets fermés de ce chalet. Puis Margaux disparaît et le récit suit ces deux destins entre la Suisse, Paris et New York. Alexis à qui tout réussi, Margaux qui se cherche et lutte pour son émancipation. La littérature sera son salut. Quand le hasard les réunit alors qu’ils ont tous les deux 50 ans et qu’ils portent en eux les stigmates de toute une vie, pourront-ils croire encore à la force de l’amour ?
Une fresque amoureuse superbe, qui nous transporte des années 80 à aujourd’hui. Ancré dans sa temporalité et sublimé par l’écriture géniale de Sarah Chiche, Aimer raconte le temps qui passe et ce qu’il fait de nos amours. Un vrai coup de cœur.
Haute-Folie, Antoine Wauters (Gallimard)
Ah… le poids de l’héritage, des silences et des non-dits. De ce qu’on ne sait pas et ce qu’on refuse de savoir : thème ô combien souvent abordé en littérature – et toujours d’actualité – qui ici trouve une puissance nouvelle sous la plume d’Antoine Wauters. Haute-Folie, c’est l’histoire d’un lieu au nom prophétique. C’est l’histoire d’une famille qu’aucun drame n’a épargnée. La naissance de Josef coïncide avec le jour où la ferme familiale prend feu ; début d’une longue série de drames dont le héros s’il n’en a pas connaissance porte en lui les démons…
Conteur de génie, dont la langue souple et hypnotique nous happe, Antoine Wauters nous emporte dans la vie de cet homme qui, lorsqu’il découvre la vérité sur son passé, décide de couper avec tous ses rêves, tout ce qu’il espérait un jour devenir. Peut-on pour autant échapper à son destin ? Un roman lumineux malgré la noirceur, qui questionne également le lien amoureux.
Nous sommes faits d’orage, Marie Charrel (Les Léonides)
« Trouve Elora ». À la mort de sa mère, Sarah se voit confier cette mission. Elle part enquêter dans un village isolé d’Albanie, où la dite Elora n’est déjà plus de ce monde depuis de nombreuses années. De l’Islande à l’Albanie, Marie Charrel nous transporte dans des paysages à couper le souffle, mais surtout nous invite à suivre les pas d’une lignée de femmes fortes et puissantes, trois générations éprises de liberté dont l’histoire se mêle à la grande Histoire. Structuré en trois époques – les années 70 et la dictature d’Enver Hoxha, le début des 90s et la chute de ce régime despotique, et enfin les années 2023-2024 – le récit suit les traces d’Elora et des siens. On est happé par la langue, tremblante, rugueuse, précise, et la justesse de Marie Charrel dont les romans sont toujours ultra documentés. Pour les férues d’Histoire, de grands espaces et de beaux récits.
Finistère, Anne Berest (Albin Michel)
Après avoir remonté le fil de sa lignée maternelle dans le très beau (et très dur) La Carte postale, Anne Berest part cette fois du côté du Finistère pour tenter de raconter son père. « C’est très difficile d’écrire sur un homme qui se tait », dit d’ailleurs Anne Berest qui avec ce livre raconte le lien aussi beau que complexe qui peut unir un père à sa fille, quand on s’aime et qu’on ne sait pas se le dire. Là encore, petite et grande histoire s’entremêlent pour raconter non seulement l’Histoire de France, vue du Finistère, mais également quatre générations d’hommes, de la Terre (avec Eugène, l’arrière-grand-père) à Polytechnique avec Pierre, le père de l’autrice. Car ici la filiation s’inscrit dans une volonté affirmée de ne pas suivre les pas de ces ancêtres pour écrire sa propre histoire. À souligner, Anne Berest a écrit ce livre à la demande de son père qui a voulu se raconter à travers son engagement politique et la théorie de la bifurcation.
Un récit très documenté, qui s’intéresse aussi la transgénéaologie et à toutes ces transmissions invisibles que l’on porte en nous, sous couvert de notre singularité.
La Maison vide, Laurent Mauvignier (Les Éditions de Minuit)
Quand la maison se vide, les voix s’effacent, mais les présences restent. Alors qu’il cherche une médaille, Laurent Mauvignier commence à fouiller dans les méandres de sa mémoire et remonte alors le fil de ses ancêtres qui ont occupé cette maison, afin de comprendre ce qui a conduit son père à se donner la mort. À travers ce décor intime et presque sacré se mêlent les récits de plusieurs générations — Marguerite, la grand-mère, Marie‑Ernestine, sa mère, et tous ceux qui ont croisé leur vie. Laurent Mauvignier entreprend alors, plume à la main, de faire revenir ces présences dans la lumière, ne fût-ce que pour libérer ce qui a été tu trop longtemps
Une véritable saga (700 pages) portée par des personnages puissants que vous n’aurez jamais envie de quitter. Coup de cœur absolu pour l’écriture dense, riche, pointilleuse jusqu’à l’obsession de Laurent Mauvigner qui vous fait pénétrer dans les âmes de ceux qu’il raconte.
Jouer le jeu, Fatima Daas (Éditions de L’Olivier)
Après le succès retentissant de La Petite dernière, adapté au cinéma par Hafsia Herzi, Fatima Daas revient avec un second roman tout autant éblouissant, qui raconte l’émancipation et la quête de soi. Lycéenne ordinaire aux écrits extraordinaires, Kayden est poussée par sa professeure de littérature à tenter le concours d’entrée à Sciences-Po. Bien qu’intéressée et surtout consciente des portes que cela pourrait lui ouvrir, Kayden doute. Comment, elle, lesbienne aux prises avec sa religion pourrait cocher les cases d’un concours si normé ? Doit-elle jouer le jeu ou doit-elle écrire sa propre histoire ?
Une langue brute, vibrante et solaire pour un récit puissant qui questionne tout autant le déterminisme que la religion, pour finalement se demander : qu’est-ce qu’être soi ?
Une Drôle de peine, Justine Lévy (Stock)
Seize ans après Mauvaise Fille, dans lequel elle racontait comment elle était devenue mère alors qu’elle était en train de perdre sa mère d’un cancer, Justine Lévy explore à nouveau le lien maternel dans Une Drôle de peine : « Est-ce que tu me vois, maman ? J’ai deux crédits à la banque, deux enfants que j’étouffe, quatre chats dont deux débiles et une estropiée, des rides en pattes d’araignée autour des yeux et des oignons aux pieds, le même amoureux qui me supporte et tient bon depuis vingt ans, quelle dinguerie, je ne suis ni parfaitement féministe, ni tout à fait écologiste, ni vraiment révoltée, pas encore alcoolique, plus du tout droguée : je mets beaucoup d’énergie à essayer de ne pas te ressembler, maman, je n’ai pas pu être une enfant et je ne sais pas être adulte. »
Justine Lévy raconte la femme cabossée qu’elle est devenue, en même temps qu’elle tente de comprendre sa mère. C’est une adresse directe à la mère disparue, une tentative de dire « je » malgré la douleur et l’héritage. Résolument, l’autrice réussit ici à transformer le chagrin en un récit lumineux, porté par une ironie douce-amère qui désamorce le pathos, grâce à un équilibre subtil entre gravité et légèreté. Un récit comme un hommage pour l’autrice qui a déclaré : « J’ai appris que l’écriture ne servait à rien. Que le deuil, de toute façon, est impossible à faire. »
Jacky, Anthony Passeron (Grasset)
Vous avez aimé Les Enfants endormis, son premier roman qui racontait le début des années Sida ? Vous allez adorer Jacky, deuxième livre d’Anthony Passeron, qui pioche une nouvelle fois dans la matière familiale pour en faire un récit. Au tournant des années 1980 et 1990, Anthony et son frère jumeau grandissent entourés d’une famille paternelle soudée, dans une vallée enclavée de l’arrière-pays niçois. Entre des grands-parents aimants, une cousine atteinte d’une maladie mystérieuse et un jeune oncle plein d’entrain, ils tuent l’ennui grâce aux jeux vidéo, une passion nouvelle, transmise par leur père : Jacky.
De la même façon qu’il alternait chapitres sur les recherches sur le sida et ceux consacrés à son histoire, Anthony Passeron va-et-vient entre l’histoire des jeux vidéos et le récit intime de cette enfance trop tôt privée de sa figure paternelle.
Une nouvelle incursion dans la France rurale et marginalisée, vu à travers le prisme des jeux vidéos, objet transitionnel qui raconte le délitement de la relation et le décrochage de la région dans laquelle il grandit.
À lire également
Rentrée littéraire : 5 lectures féministes inspirantes
Livres : la mode sous toutes ses coutures
Romance d’été : 4 livres pour rêver au soleil