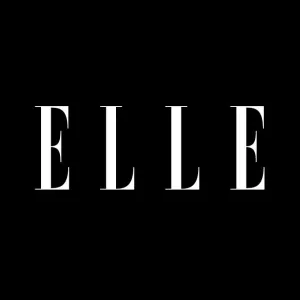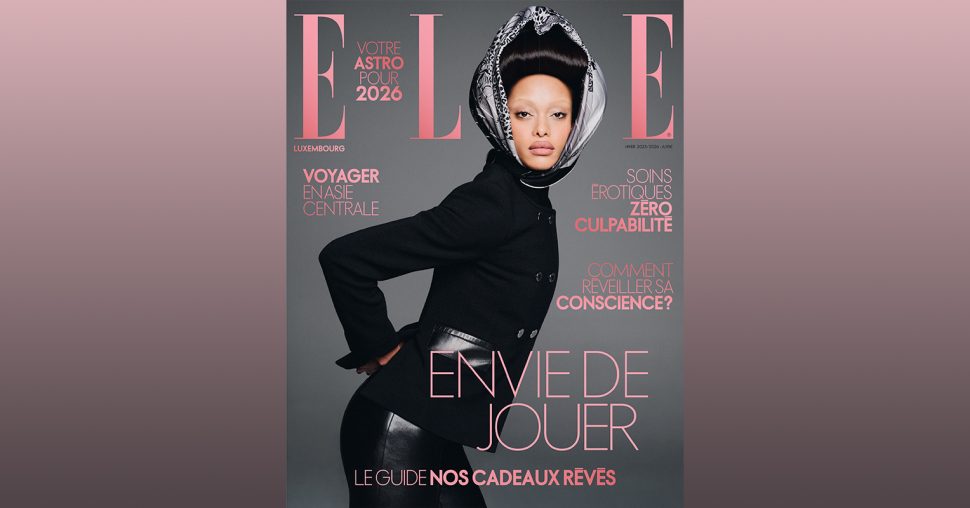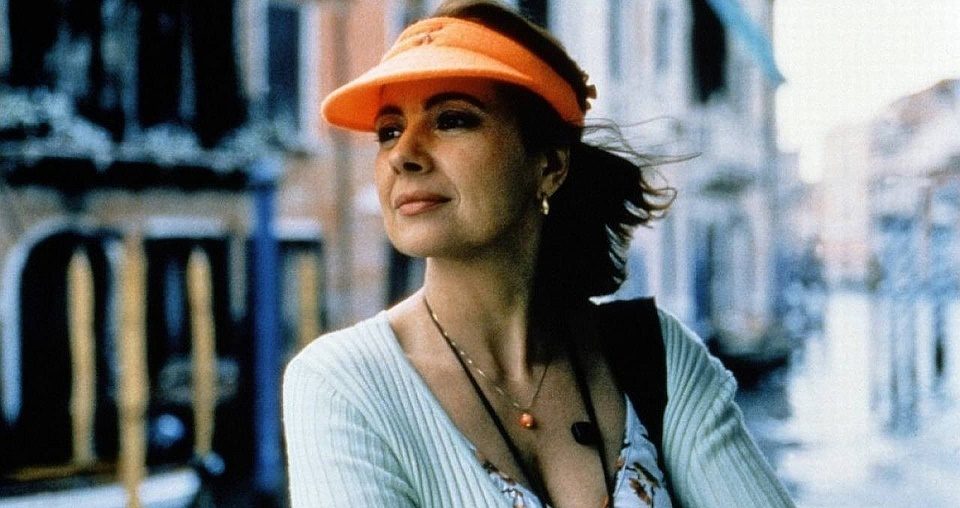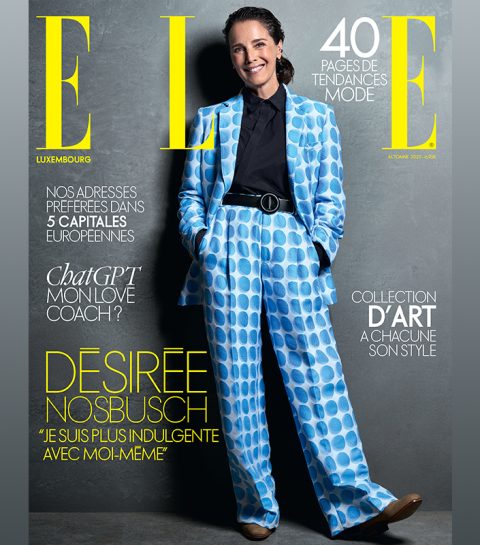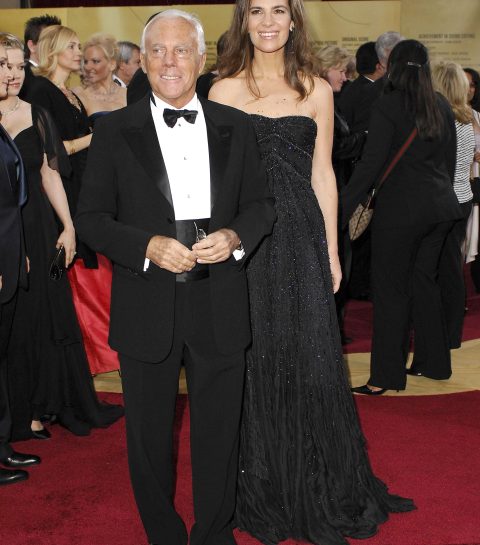Son parcours, son ton et sa détermination imposent le respect d’emblée. Élue présidente du Planning familial luxembourgeois le 25 juin dernier, Fatima Rougi entre en fonction dix ans après y avoir mené ses premiers combats, alors que l’organisation souffle ses 60 bougies. Elle arrive avec une vision, des priorités claires, et une énergie à la fois offensive et lucide : « le Planning est un lieu d’engagement, de soin, de transmission. Mais c’est également un espace politique ».
Une trajectoire en diagonale
Elle n’a jamais suivi un chemin rectiligne, et c’est ce qui fait sa force. Née au Maroc, Fatima Rougi grandit en Corse, loin des centres institutionnels, mais au cœur de plusieurs identités « c’est sûrement de là que je tiens mon opiniâtreté et ma détermination », plaisante-t-elle. Cette complexité ne l’a jamais freinée. Au contraire, elle l’assume pleinement. Elle étudie, écrit, travaille dans les médias, s’engage dans des projets culturels et citoyens. Chaque étape, chaque détour, elle les revendique. « Je n’ai jamais compartimenté mes vies. Journaliste ou militante, communicante ou bénévole : c’est toujours moi. Ce qui m’anime, c’est le collectif et l’impact ».
« Mon premier contact avec le Planning se fait à 17 ans en Corse : c’est le Planning qui a fait mon éducation sexuelle. Je souhaitais obtenir des informations sur mon corps, que je trouvais pas dans ma famille musulmane. À ce moment, je me suis fait la promesse de rendre au Planning ce qu’il m’avait donné ». Son action au Planning s’inscrit donc naturellement dans cette logique : créer des ponts, faire bouger les lignes, faire entendre des voix qui ne le sont pas. Sa nomination incarne une génération qui ne veut plus choisir entre efficacité et radicalité, entre parole politique et action concrète.
Continuité et rupture
Comme une évidence, elle succède à Ainhoa Achutegui, qui dirige le Planning depuis dix ans. De fait, Fatima Rougi salue la cohérence de la ligne et des combats tenus jusqu’ici, mais elle ne cache pas non plus sa volonté d’infléchir certains curseurs, d’accélérer là où ça bloque. « Je m’inscris dans une continuité, en y apportant ma propre sensibilité. Chaque présidence a sa tonalité, et la mienne se teintera d’un franc-parler assumé, d’une attention renforcée aux stratégies politiques et d’un engagement fort pour une approche résolument intersectionnelle. Je souhaite aussi contribuer à faire rayonner davantage l’image du Planning, à la hauteur de son rôle essentiel dans notre société. Mais il ne faut jamais oublier qu’en endossant ce titre, je n’agis pas en tant que Fatima Rougi. Je suis la voix du Planning familial, de tous celles et ceux qui y travaillent au quotidien, comme de son conseil d’administration. Les décisions se prendront toujours de manière collégiale ».
Cette volonté de ne pas jouer la rupture frontale tout en affirmant son style personnel témoigne de sa maturité politique. Pas besoin de casser ce qui fonctionne. Mais il faut, selon elle, oser poser les questions qui fâchent, ouvrir des fronts trop longtemps repoussés.
Sexualité, société, données : combler les angles morts
Fatima Rougi ose évoquer des sujets qui dérangent, mettre des mots sur ce qui, aujourd’hui encore, demeure tabou. Elle les nomme, les expose, les politise. À commencer par un constat : au Luxembourg, il n’existe quasiment aucune donnée publique consolidée sur la santé sexuelle. Pas de chiffres sur l’âge du premier rapport, l’usage réel des contraceptifs, la fréquence des IVG, ou encore l’accès aux protections hygiéniques. « On avance dans le noir. Comment élaborer une politique de santé publique si on ne sait même pas de quoi on parle ? » Ce manque d’informations reflète, selon elle, un déni culturel autour des questions liées au corps, au sexe, à la parentalité non désirée. « Il y a encore une peur panique de regarder la sexualité en face, autrement qu’en termes de risques ou de morale. »
L’avortement, toujours sous tension
L’un de ses premiers combats, en tant que présidente, est de sécuriser le droit à l’avortement. Elle ne s’en cache pas : « Même ici, même en 2025, le droit à l’IVG reste fragile. On ne pas nier ce qui se passe partout en Europe et dans le monde, la montée de l’extrême droite ». La législation actuelle limite le délai à 12 semaines, un seuil jugé trop court par les professionnel·les de santé comme par les personnes concernées. Fatima Rougi plaide pour une extension à 14 semaines, à l’instar de la France. Une évolution qu’elle juge à la fois nécessaire et urgente. « On ne peut pas parler de droit effectif si ce droit est conditionné par une course contre la montre, des tabous, ou des disparités d’accès ».
Elle rappelle aussi que la pression ne vient pas seulement de la loi. Les conservatismes culturels, le manque de professionnels formés, les refus de certains médecins, les inégalités d’accès aux soins, les violences administratives sont autant de freins invisibles à l’autonomie reproductive. Et le Planning, selon elle, doit rester une vigie. Pas une structure purement technique ; une force politique.
Un féminisme situé, assumé
Fatima Rougi parle de féminisme sans formule toute faite. Chez elle, il est vécu, pensé, incarné. Intersectionnel, toujours. Pas comme posture universitaire, mais comme réalité vécue. « Le féminisme d’une femme blanche qui a fait des études, ce n’est pas celui d’une femme racisée, sans papiers, qui élève seule ses enfants. Et pourtant, elles doivent pouvoir se retrouver dans le même combat ».
Sa propre trajectoire l’a rendue sensible à ces écarts. Elle se souvient d’avoir vu, trop souvent, des femmes réfugiées passer les portes du Planning avec des traumatismes lourds, et une énorme difficulté à parler. « Quand on vient d’un milieu marginalisé, quand on a grandi avec la honte du corps, ou la peur de la sexualité, on ne s’autorise pas à poser des questions. Il faut des relais. Il faut des espaces – et des personnes – qui comprennent ça ».
Éduquer pour transformer
La présidente du Planning Familial le répète : la prévention ne suffit plus. Il faut aller plus loin, plus tôt, plus franchement. Elle plaide pour une éducation sexuelle structurée dès le plus jeune âge, dans tous les contextes, écoles, foyers, centres de santé. Pas pour faire peur, mais pour faire comprendre. « La sexualité est encore trop souvent abordée de manière négative ; on parle toujours des risques. Mais qui parle du désir ? Du consentement ? Du respect de soi ? ». Bref, elle prône une approche complète, inclusive, positive : « le sexe c’est tout de même quelque chose de joyeux, il faut aussi le dire ». Sa vision de l’éducation à la sexualité parle de rapports de pouvoir, de plaisir, d’égalité. Mais également de sujets qui fâchent, à l’instar des plus jeunes pour qui le préservatif n’est pas un réflexe. Car les signaux d’alerte s’accumulent. Les infections sexuellement transmissibles sont en forte hausse au Luxembourg. Et cette réalité ne fait l’objet d’aucune campagne sérieuse, déplore-t-elle. « On le constate sur le terrain depuis longtemps, mais il a fallu que les premiers chiffres sortent pour que le gouvernement commence à bouger. On ne peut plus faire l’économie d’une vraie politique de prévention ».
La précarité, angle mort du débat public
Fatima Rougi alerte sur une autre faille du système : l’augmentation de la pauvreté au Luxembourg, et son impact direct sur les femmes. « Il y a de plus en plus de femmes précaires qui viennent au Planning. Et beaucoup sont seules, isolées, ou avec des enfants à charge ». Ce ne sont pas des situations anecdotiques, mais des réalités de plus en plus fréquentes, liées à une dégradation du niveau de vie et à un coût de la vie toujours plus élevé. Elle le voit tous les jours : quand tout est trop cher, la santé devient une variable d’ajustement. « Chez nous, tout est gratuit. Mais si la précarité continue d’augmenter, on risque de ne plus suivre ».
Cette précarité a des effets réels : accès aux soins plus compliqué, rupture du lien social, invisibilisation des besoins. « Et on ne peut pas continuer à faire comme si tout le monde avait les mêmes ressources, les mêmes accès, les mêmes marges de manœuvre ».
Une résistance joyeuse et non sacrificielle
Si la tâche est ardue, Fatima ne veut pas d’un militantisme sacrificiel. Elle parle de « résistance joyeuse ». Un oxymore ? Plutôt une stratégie. « Le sérieux, ce n’est pas la lourdeur. On peut faire les choses bien, avec efficacité, sans s’épuiser à pleurer. Moi, j’ai besoin de rire, de lien, de collectif ».
Elle évoque avec franchise la fatigue, les lenteurs administratives, les promesses non tenues. Elle cite la réforme sur la TVA des protections menstruelles, pour laquelle elle a dû se battre pendant quatre ans, entre pétitions, mails, rendez-vous, articles, et lobbying. « J’y croyais dur comme fer, et pourtant, ça a pris un temps fou. Mais on a gagné. Et ça, personne ne nous l’enlèvera ».
Pour un Planning politique
Le mission du Planning ne peut être réduite à la sensibilisation. « On est là pour défendre un droit fondamental : celui de disposer de son corps. Et ce droit est politique. Il touche à l’égalité, à la justice, à la dignité », explique la nouvelle présidente du Planning Familial.
Elle tient à ce que l’organisation reste vigilante, offensive, active dans l’espace public. Pas militante au sens partisan, mais résolument engagée. Pour elle, ce sont les institutions qui doivent s’adapter à la réalité des corps, pas l’inverse. « On sait pourquoi on est là. On ne lâche pas. Et on ne lâchera pas ».
À lire également
Rentrée littéraire : 5 lectures féministes inspirantes
Rokhaya Diallo : « Les femmes ont une capacité de résistance inébranlable »