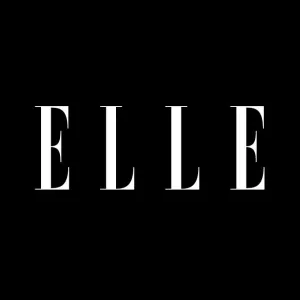À chaque époque ses lubies alimentaires : les années 1990 ont diabolisé les graisses, les suivantes ont déclaré la guerre au sucre. Depuis 2020, le code a changé : les protéines sont désormais au centre de l’attention, non pas comme coupables, mais comme sauveuses supposées de nos corps et de notre vitalité.
C’est bien simple, elles promettent tout : prévenir la fonte musculaire, ralentir le vieillissement, favoriser la satiété, dessiner la silhouette. Un cocktail de promesses qui sature les fils d’actualité, comme les rayons des supermarchés et des boutiques spécialisées. Mais derrière les shakers pastel et les barres, se cache une équation beaucoup plus complexe, surtout pour les femmes. ELLE Luxembourg s’est penché sur la question.
Combien de protéines faut-il vraiment ?
Les besoins varient selon l’âge, le poids et l’activité physique. La recommandation générale est de 0,8 g/kg/jour pour une personne sédentaire. Une femme sportive régulière (3 à 5 séances par semaine) peut viser 1,2 à 1,6 g/kg/jour, voire 1,8 g/kg/jour lors d’entraînements intensifs. « Mais ce qui compte, ce n’est pas la quantité brute, c’est la répartition et la qualité », insiste Lucile Champy, nutritionniste. « Le corps ne peut pas assimiler plus de 25 à 30 g par repas. L’excédent ne sert à rien. Il faut répartir ses apports sur la journée : un petit-déjeuner riche en protéines pour soutenir la dopamine et la concentration, un déjeuner équilibré, et un dîner plus léger pour ne pas interférer avec la production de sérotonine et de mélatonine ».
La qualité, l’autre enjeu
Car toutes les protéines ne se valent pas : les protéines animales (œufs, poissons, volaille, viande maigre, produits laitiers) offrent une valeur biologique élevée, c’est-à-dire un profil complet en acides aminés essentiels. Mais leur surconsommation, notamment de viandes rouges ou très transformées, augmente le risque d’inflammation chronique et de stress oxydatif.
Les poudres de whey native sont intéressantes pour les sportives, à condition d’être bien choisies : « peu d’additifs, pas de sucres cachés (dextrose, maltodextrine, fructose) et des parfums simples comme vanille ou chocolat, souvent les plus sûrs », recommande Lucile Champy. Pour les végétariennes ou intolérantes, les protéines de pois, riz ou chanvre constituent une alternative solide, à condition de vérifier leur complémentarité en acides aminés essentiels.
Mais la vigilance reste de mise : les allégations « brûle-graisse », « sans sucre », « repas complet » ou « fit detox » relèvent souvent plus du marketing que de la nutrition. C’est un secteur qui joue sur la peur du manque .
Se pose également la question de la digestibilité : les protéines isolées, comme celles des poudres, manquent de fibres, de vitamines et de micronutriments. Résultat : elles rassasient mal et peuvent perturber le microbiote intestinal à long terme. À ce titre, Manon Kimmel, du Comptoir de la Santé au Luxembourg insiste sur l’importance d’alterner les origines : « consommer quotidiennement la même source (par exemple exclusivement caséine ou blanc d’œuf) peut, chez certaines personnes, aggraver la perméabilité intestinale et déséquilibrer le microbiote ». De même, elle pointe du doigts les nombreux additifs « dont certains ont des effets potentiels délétères sur le microbiote : colorants, nitrites/nitrates, certains conservateurs et épaississants à l’instar des E214–E219, E249–E252, E210–E213, E230–E235, E407/E407A, E412, E460–E469, E900, dérivés d’aluminium ».
Quand le trop devient risqué
Contrairement à une idée reçue, l’excès de protéines n’est pas anodin. Une étude parue dans le Journal of Women’s Health (2015) a mis en évidence un lien entre apport protéique élevé et augmentation des marqueurs inflammatoires, notamment chez les femmes ménopausées. Une consommation excessive, surtout d’origine animale, peut accentuer la charge acide de l’organisme, favoriser l’inflammation des tissus et, à long terme, accroître le risque d’accidents vasculaires cérébraux.
Chez les femmes, ces effets sont renforcés par la fluctuation hormonale : avant les règles, la sensibilité à la douleur et à l’inflammation augmente naturellement. Certaines recherches ont même identifié une protéine impliquée dans les douleurs menstruelles (la RGS2), preuve que le lien entre protéines et santé féminine reste plus subtil que les slogans marketés de marques de compléments alimentaires. « Un apport trop élevé sur la durée, c’est aussi moins de place pour d’autres nutriments essentiels : fibres, calcium, vitamines, bons gras », avertit Lucile Champy. « C’est là que le déséquilibre s’installe ».
En outre chez une femme en bonne santé, aucun risque rénal ou hépatique n’est démontré jusqu’à 2 g/kg/jour, à condition d’une bonne hydratation (au moins 1.5 l d’eau plate par jour) et d’une fonction rénale normale. A contrario, en cas d’insuffisance rénale, de pathologie hépatique ou de régime hyper-protéiné prolongé sans suivi par un médecin, les excès peuvent devenir délétères.
Enfin, les intolérances peuvent également entrer en ligne de compte, dans la mesure où « la caséine et la protéine d’œuf peuvent provoquer des symptômes digestifs (ballonnements, inflammations) chez des personnes présentant une altération de la barrière intestinale », souligne encore Manon Kimmel.
Une histoire d’équilibre
Les études montrent qu’il n’existe pas de « dose miracle ». Trop peu, et le corps perd en force, en densité osseuse, en concentration. Trop, et l’inflammation, la fatigue et les déséquilibres métaboliques s’installent. Pour les femmes, la nuance est d’autant plus cruciale que leur métabolisme fluctue au rythme du cycle, des hormones ou de la ménopause.
La clé se joue moins dans la poudre que dans la répartition, la diversité et la qualité des apports. « Je dis souvent à mes clientes : il ne faut pas manger moins, mais manger mieux », résume Lucile Champy. « Des protéines bien choisies, bien réparties, intégrées à une assiette complète ».
Une obsession sous influence
Sur TikTok, Instagram ou YouTube, les protéines s’affichent comme le symbole d’une vie healthy, disciplinée, cadrée et performante. Les « fitfluencers » vantent la whey vanille au petit-déjeuner, la barre post-entraînement, ou le shake du soir pour récupérer « sans grossir ».
Mais cette logique inquiète les professionnels de santé qui s’inquiètent du fait que désormais tout un chacun, parce qu’il a perdu du poids et/ou s’est musclé, peut se proclamer expert en nutrition et prodiguer ses conseils sans aucune base scientifique. Car nombreuses sont les abonnées à suivre sans recul ces conseils, et les dérives sont fréquentes : restrictions, carences, troubles du comportement alimentaire. « Ce n’est pas parce qu’on mange qu’on est nutritionniste, pas plus que se faire opérer ne fait de vous un chirurgien. Lire trois articles sur la nutrition ne donne pas une légitimité à prodiguer des conseils alimentaires », déclarait au printemps 2025 sur France Inter le médecin endocrinologue diabétologue Boris Hansel, tout en reconnaissant qu’il était temps pour les médecins de « faire de l’influence » pour que les gens puissent trouver du vrai conseil de qualité sur Internet, à l’instar de la chaîne Youtube PUMS (Pour Une Meilleure Santé), une chaîne santé grand public, co-produite par le studio vidéo d’Université Paris Cité et Solis Studio.
Dans le cadre de l’avènement des protéines, le souci est encore différent : ce n’est pas tant la protéine qui pose problème, que le culte de la performance qui l’entoure. Longtemps considérée comme un simple nutriment, elle est devenue un symbole : celui d’un corps optimisé, calibré, productif. La protéine n’est plus seulement une molécule essentielle à la reconstruction musculaire, elle est désormais investie d’une charge symbolique, celle du contrôle de soi, du dépassement permanent, de la maîtrise absolue. Ce glissement est révélateur : un besoin physiologique élémentaire s’est transformé en un levier marketing. Les marques comme les influenceurs ont saisi cette faille entre santé et apparence, entre vitalité et compétitivité. Avaler son shaker s’apparente alors à un rituel de conformité, et la performance cesse d’être un choix pour devenir une injonction : celle d’un corps qui doit toujours mieux faire, mieux paraître, mieux durer.
TO-DO
- Varier les sources : alternez protéines animales / végétales sur la semaine pour couvrir tous les acides aminés et ménagez votre microbiote.
- Lire la composition : évitez les poudres avec longue liste d’additifs chimiques et privilégiez celles indiquant l’origine des protéines et le profil en acides aminés.
- Ne pas surdoser : visez une répartition (~25–30 g/pro repas utile) et adaptez votre total à votre activité physique (0,8 g/kg si sédentaire ; 1,2–1,8 g/kg si active/intense).
- Hydratation & suivi : buvez suffisamment (≥1,5 L/jour) et consultez un professionnel si vous envisagez un régime hyperprotéiné prolongé ou si vous souffrez d’une pathologie rénale/hépatique.
- Limiter les additifs : privilégiez conservateurs et antioxydants naturels (vitamine C/E, extraits de romarin, lactates…) plutôt que E-nombres synthétiques listés.
À lire également
Collagène, cellulite et marketing : ce qu’on vous dit (et ce qu’on oublie de vous dire)