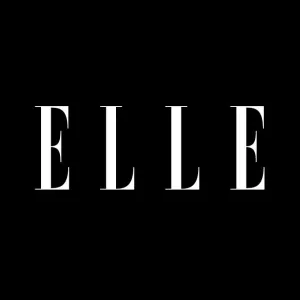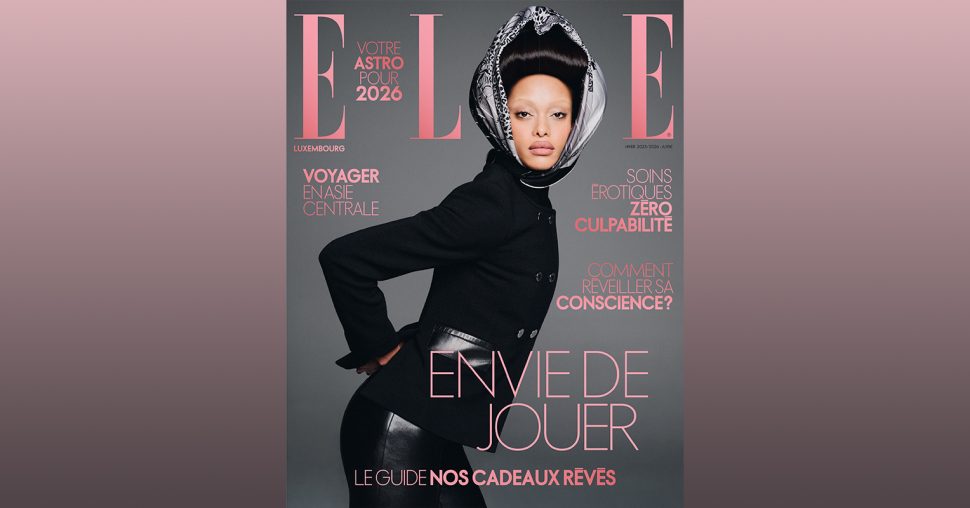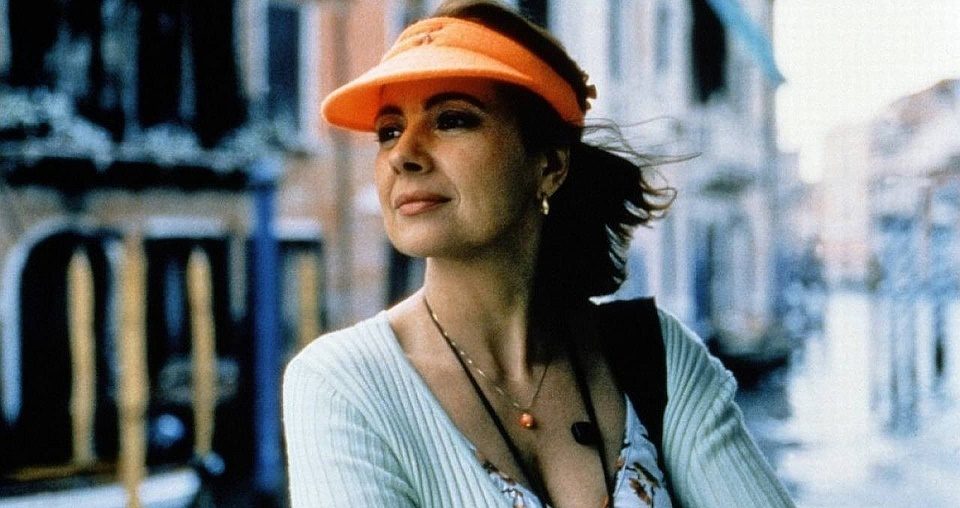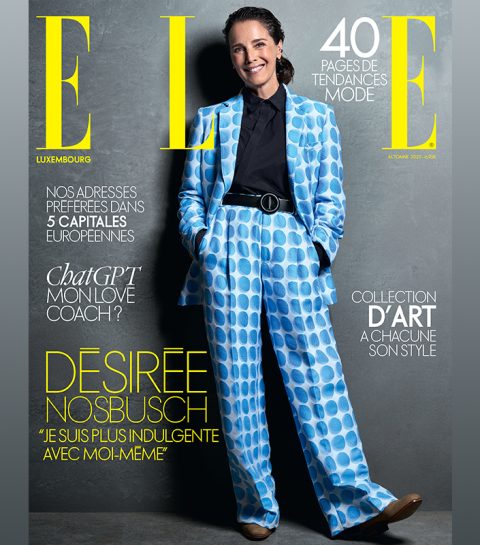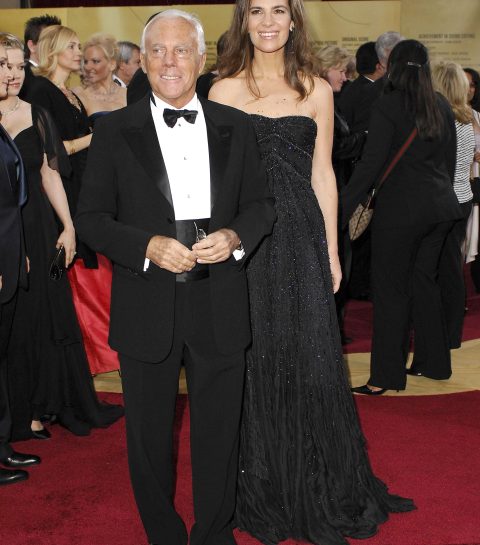Depuis la tribune du député Gérard Schockmel publiée dans le Luxemburger Wort, le débat sur l’avortement a ressurgi au Luxembourg. Dans ce texte, l’élu DP accuse le féminisme d’avoir « confisqué » la parole sur l’IVG et s’oppose à son inscription dans la Constitution. Un argumentaire anachronique, voire dangereux, dans un pays où le droit des femmes à disposer de leur corps n’est acquis que depuis quelques décennies.
Face à cette sortie, la réaction du Planning familial ne s’est pas faite attendre : « Si le débat sur l’avortement est aujourd’hui porté par les féministes, c’est tant mieux. Sans elles, il n’y aurait peut-être pas de débat du tout, ni de droit ». Une phrase qui résume à elle seule un demi-siècle de luttes. Non, le féminisme n’a pas étouffé la discussion : il l’a rendue possible. Fatima Rougi, présidente du Planning Familial précise quant à elle : « s’il est aujourd’hui possible à M. Schockmel d’exprimer librement ses opinions dans une page entière du principal quotidien du pays, c’est bien la preuve qu’il n’est ni censuré ni réduit au silence, contrairement à ce qu’il sous-entend… ».
Héritage et déformation
Pour justifier sa position, Schockmel tente le tout pour le tout en osant emprunter les propos de Simone Veil, symbole historique de la légalisation de l’avortement, dont il tord tranquillement le message. En rappelant que « aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement », Veil n’appelait pas à la restriction, mais bien à la compassion. La citer pour restreindre le droit qu’elle a défendu, c’est trahir son héritage. Comme le souligne le Planning familial, la loi Veil n’a pas « autorisé » l’avortement : elle a mis fin à l’hypocrisie et à la souffrance des femmes.
Au Luxembourg, la dépénalisation n’a été acquise qu’en 2014, et l’inscription du droit à l’IVG dans la Constitution vise désormais à le protéger de tout recul ; ce qui à la lecture de cette tribune nous semble d’autant plus urgent.
La Ministre de l’Égalité Yuriko Backes a d’ailleurs dénoncé la tribune comme « profondément rétrograde », rappelant que les femmes n’ont pas à se justifier d’exister dans l’espace démocratique.
Les chiffres derrière le droit
Les données les plus récentes du Planning familial montrent que l’IVG est une réalité concrète, loin des caricatures idéologiques. En 2023, 1 193 femmes ont formulé une demande d’avortement au Luxembourg, soit une hausse de 46 % par rapport à 2022. Parmi elles, 898 IVG ont été planifiées, et 98,8 % réalisées dans le pays. La moyenne d’âge de la grossesse au moment de l’intervention était de 4,6 semaines, et 87 % des IVG ont eu lieu avant la neuvième semaine.
Contrairement aux clichés, il ne s’agit pas d’un geste « banalisé » : plus de 50 mineures ont eu recours à une IVG en 2023, certaines âgées de moins de 16 ans, tandis que près de la moitié des femmes concernées avaient entre 25 et 34 ans. Autant de profils différents, mais une réalité commune : la nécessité d’un accompagnement médical et psychologique encadré.
Ces chiffres révèlent aussi l’importance du Planning familial, qui assure chaque année des centaines de consultations et de suivis post-IVG. Et rappellent qu’au Luxembourg, il n’existe aucune statistique nationale exhaustive sur l’ensemble des avortements pratiqués, ce qui rend le débat d’autant plus fragile.
Un droit à défendre, au Luxembourg comme ailleurs
Le débat intervient alors que, dans le monde, le vent tourne. Depuis la révocation de la jurisprudence Roe v. Wade aux États-Unis, les États les plus conservateurs ont multiplié les interdictions, replongeant des milliers de femmes dans la clandestinité. Selon Amnesty International, les avortements illégaux y ont bondi, et les conséquences psychologiques sont « dévastatrices ». La chercheuse Esther Duflo évoque même une « crise de santé mentale » liée à la peur, à la honte et à l’absence de soins.
Ce recul illustre un phénomène global : le backlash contre les droits des femmes. Au nom d’une liberté d’expression « équilibrée », les discours masculinistes se multiplient. Évidemment, ce sont souvent des hommes – absolument non concernés par les réalités physiques ni sociales de la maternité – qui prétendent aujourd’hui décider du corps des femmes. En témoigne un écho inquiétant du slogan inversé : « Vos corps, nos choix » repris au lendemain de l’élection de Trump au pouvoir.
Le danger de la normalisation
Rappelons que le Wort a déjà été pointé du doigt voilà quelques mois pour avoir offert une tribune à une personnalité accusée de pédophilie. Faut-il y voir un virage idéologique ? En publiant un texte ouvertement antiféministe, le quotidien s’aventure sur un terrain glissant, il normalise des positions qui fragilisent le débat démocratique. Le pluralisme ne consiste pas à juxtaposer les extrêmes ; il suppose de rappeler les faits, les contextes et les droits.
Le droit à l’avortement n’est pas une idéologie, mais un pilier de la démocratie. L’inscrire dans la Constitution met en lumière le fait que la liberté de choisir ne doit plus jamais dépendre des humeurs politiques, ni des colonnes d’un quotidien nostalgique d’un autre âge.
À lire également
Fatima Rougi : la nouvelle voix du Planning familial
IVG : où en est-on au Luxembourg ?
L’IVG accessible à toutes en Europe ? Une pétition déclenche un débat à Bruxelles