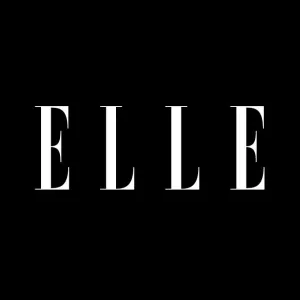Au Luxembourg comme ailleurs, on ne compte plus les vidéos TikTok où des personnes, mi-amusées mi-désabusées, racontent leur « situationship ».
Ni tout à fait couple, ni vraiment plan cul, cette relation sans définition s’est imposée comme le miroir (aux alouettes) de nos amours modernes. À l’ère du swipe infini, où Tinder, Bumble et consorts transforment les rencontres en un catalogue inextinguible d’options, le flou est devenu une norme. Plus besoin d’être « en couple » pour partager des moments, plus d’étiquette à coller pour exister à deux. La situationship séduit justement par cette promesse d’autonomie et de souplesse : une liberté affective qui s’accorde avec une vie saturée d’urgences et d’opportunités.
Mais derrière l’illusion d’un contrôle total, beaucoup découvrent la face cachée de cette zone grise. Si elle peut donner l’impression d’une émancipation, l’absence de règles s’accompagne souvent et surtout d’une insécurité sourde : « on est ensemble ou pas » ? À ce sujet, les psychologues évoquent un terrain fertile pour l’anxiété et la frustration, où l’on jongle sans cesse entre empowerment et désillusion. Dans cette économie du flou relationnel, entretenue par les applis et par une culture de l’instant, le désir de liberté se heurte à une vérité tenace : celle d’un besoin persistant de clarté, d’ancrage et de sincérité.
Jeu, swipe et match…
Le terme « situationship » (néologisme né de la contraction de « situation » et de « relationship ») est apparu pour la première fois au milieu des années 2010, au moment où les applications de rencontre sont devenues la porte d’entrée principale vers la vie amoureuse. Simplifier la rencontre, abolir les frontières et multiplier les opportunités : une promesse à double tranchant doublée, surtout, d’un redoutable effet secondaire, celui de transformer l’intimité en un marché de l’instant, qui décuple les possibles et où tous les coups sont permis.
Cette logique favorise ce que les chercheurs appellent le « paradoxe du choix » : plus les options sont nombreuses, plus il devient difficile de s’arrêter sur une seule. La situationship s’inscrit dans ce contexte d’essai permanent. Comprenez, pourquoi s’engager pleinement quand, d’un simple swipe, d’autres horizons s’ouvrent ? C’est le règne du « pourquoi pas » : on se voit, on partage des moments, mais sans jamais verrouiller la porte à d’autres possibilités.
Une liberté ultra séduisante de prime abord
Si ces relations ambiguës se multiplient, c’est parce qu’elles répondent à une aspiration contemporaine : celle de préserver son indépendance chérie. La situationship offre l’intimité, sans les contraintes du couple officiel. Pas de projections à long terme, pas d’obligation de justifier ses choix ou d’intégrer son partenaire à chaque pan de sa vie. Pas de soirées interminables avec ses potes ni de déjeuners avec la belle-famille. Bref, pas de contraintes at all. Pour beaucoup, cette liberté est un soulagement ; forcément, on ne prend que le meilleur. La situationship permettrait donc in fine de se concentrer sur soi, ses études, sa carrière, ses projets perso, tout en s’offrant les joies de nuits de sexe régulières. Franchement, qui ne signerait pas ce contrat ?
Lou*, 28 ans, vit une relation ambiguë depuis plusieurs mois. « On n’est pas vraiment “en couple”, même si tout se passe comme si c’était le cas. On part en vacances, on voit nos amis respectifs, on couche ensemble… Mais elle voulait une relation “légère”, sans jamais mettre un mot dessus. Au début, j’étais ok, mais au fil du temps, c’est devenu de plus en plus lourd d’avoir des sentiments sans pouvoir en parler ».
Dans une société où l’on revendique le droit de choisir ses propres règles, la situationship apparaît presque comme un modèle adapté à une génération pressée et multitâches ; un compromis idéal où l’on vit l’instant, sans promesses écrasantes ni responsabilités prématurées.
#Situationship : entre mèmes, likes et larmes
Les réseaux sociaux ont largement contribué à la popularisation du concept… mais également de ses limites. Sur TikTok, le hashtag #situationship regroupe des millions de vidéos, souvent humoristiques, où les utilisateurs partagent anecdotes et conseils. Certaines vidéos présentent la situationship comme un mode de vie léger et franchement fun, une manière de profiter sans pression. D’autres, au contraire, révèlent les coulisses plus sombres : les attentes déçues, la confusion, la difficulté à mettre des mots sur une relation.
Cette double narration est révélatrice : d’un côté, les plateformes banalisent le flou relationnel, le transforment en culture commune et en objet de comédie ; de l’autre, elles révèlent l’insécurité et l’anxiété émotionnelle qu’il génère. Comme le note cette vidéo virale de Jilian Turecki : « Don’t settle for crumbs. You deserve the whole meal ». Autrement dit, accepter une situationship, c’est souvent se contenter de miettes, tout en espérant qu’elles se transforment en festin.
Résolument, ce mélange – un tantinet schizo, il faut le reconnaître – de fierté et de malaise illustre bien toute l’ambivalence du phénomène. Les réseaux sociaux permettent de trouver une forme de communauté dans le flou « ouf, je ne suis pas seul·e à vivre ça », mais ils exposent aussi crûment les blessures qu’il entraîne.
L’amour et la violence
Ce qui distingue la situationship d’un simple flirt ou d’une amitié amoureuse, c’est sa durée. À force de s’installer, le flou finit par peser. Les psychologues notent que ces relations entretiennent une incertitude constante, un stress d’arrière-plan qui peut fragiliser l’estime de soi.
« Moi, je suis gay. Lui, il était hétéro en couple avec un enfant quand on s’est rencontré. Au bout de quelques temps, il a déménagé chez ses parents. On s’est avoué nos sentiments, mais malgré ça, la relation n’évolue pas. Je suis clairement plus investi, alors que lui s’implique comme il peut, avec ses blocages. Ce décalage, au quotidien, c’est très compliqué à vivre », raconte Dany, 29 ans.
Le problème quant à lui tient moins à la nature intrinsèque de la relation que du déséquilibre qu’elle instaure : l’un des deux partenaires est satisfait du statu quo, tandis que l’autre espère une évolution. Mais comme rien n’est dit – puisqu’on refuse de communiquer pour statuer sur la nature de la dite relation –, chacun avance dans l’ambiguité. Et plus le temps passe, plus la frustration grandit. Sortir d’une situationship peut alors être plus douloureux qu’une rupture classique, car il n’y a jamais eu d’engagement officiel à rompre, seulement un espoir qui s’effondre.
Rupture sous silence
La difficulté tient en effet au caractère informel de la relation : sans statut reconnu, il n’y a ni annonce officielle ni étapes symboliques de séparation. Il n’est pas question d’une relation qui s’arrête, plutôt d’une absence soudaine : un message qui ne vient plus, une mise à distance progressive jusqu’au point de non-retour. Ce silence crée un vide que l’on peine à nommer, et donc à dépasser.
Les psychologues soulignent que cette absence de cadre complique le processus de deuil. Dans une rupture traditionnelle – en règle générale – , les partenaires se confrontent, mettent des mots sur ce qui a échoué, clôturent une histoire. Dans une situationship, au contraire, tout reste en suspens. On se demande si la relation a vraiment existé, si l’autre a ressenti la même intensité ; surtout, on se demande si cette connexion n’a pas été finalement que rêvée. Un flou artistique, donc, dans laquelle puise la rumination : on rejoue les conversations, on interprète les silences, on se demande ce qui aurait pu être dit ou fait différemment. Bref, on se remet soi-même en question, quand c’est la nature du lien elle-même qui posait problème.
Ce type de fin est souvent comparé à un « ghosting émotionnel » : l’un des deux s’éloigne, parfois sans explication, et l’autre reste seul avec ses projections. Comme il n’y a jamais eu d’engagement officiel, la douleur peut sembler moins légitime aux yeux des proches. On hésite à en parler, par peur d’être jugée. Pourtant, l’investissement émotionnel est bien réel. Et c’est précisément cette absence de reconnaissance sociale qui rend la blessure plus sourde et plus longue à cicatriser.
Enfin, la situationship laisse derrière elle une trace bien particulière : celle d’un futur imaginé, mais jamais réalisé. Car, ici c’est le potentiel d’une relation fantasmée qui s’éteint. On ne perd pas seulement une personne, mais une projection, une promesse implicite. Cette dimension explique pourquoi tant de témoignages décrivent la sortie d’une situationship comme une expérience de perte disproportionnée par rapport à la durée réelle de la relation.
Quand le cool devient lourd
Si la situationship s’est imposée, c’est qu’elle correspond à une époque en quête de flexibilité. Mais cette liberté affichée finit bien souvent par se retourner contre ceux qui la recherchent. Plusieurs enquêtes montrent qu’une majorité de jeunes adultes ayant vécu une situationship en gardent un sentiment négatif : impression de perte de temps, d’avoir été manipulés ou de s’être eux-mêmes trompés.
On observe d’ailleurs un phénomène intéressant : après plusieurs expériences de ce type, une partie de la génération Z exprime une lassitude. Lassitude d’attendre des signaux qui ne viennent pas, lassitude de jongler avec l’incertitude, lassitude de voir l’intime réduit à un entre-deux permanent. Comme si, après avoir testé l’amour flou, certains revenaient vers une aspiration plus simple : savoir clairement où l’on en est.
À époque floue, amours floues
La situationship n’est pas seulement une tendance, c’est un révélateur des tensions qui traversent nos vies affectives. Elle traduit à la fois la volonté d’échapper aux contraintes du couple traditionnel et l’incapacité à renoncer au désir de reconnaissance et de stabilité.
Cette contradiction en dit long sur notre époque. Nous voulons être libres, mais nous cherchons à être rassurés. Nous refusons les étiquettes, mais nous attendons qu’un lien soit reconnu. Nous multiplions les expériences, mais nous espérons trouver la profondeur.
La situationship, entre promesse d’émancipation et risque de désillusion, s’impose comme le miroir de nos contradictions intimes. Elle raconte moins une mode passagère qu’un moment culturel : celui d’une génération qui oscille entre la quête de liberté et le besoin de certitudes.
* le prénom a été modifié
À lire également
Le body count ou l’art de mesurer la valeur d’une femme au lit
Dating burn-out : la déception des applis de rencontres