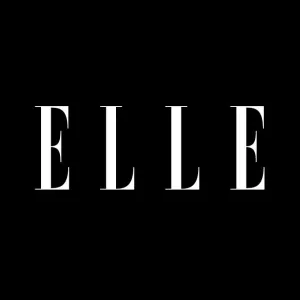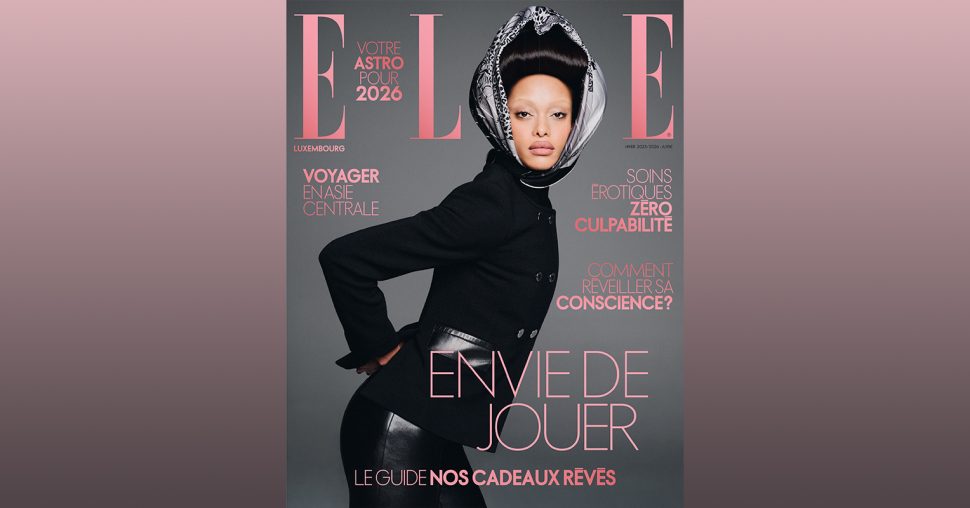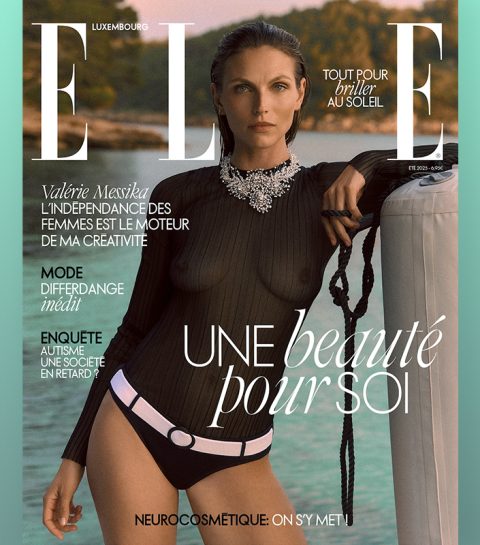Cet été, je suis tombée sur ce post « Boring is the new cool » partagé par une influenceuse que j’aime beaucoup. La citation colle plutôt bien à son mode de vie, paisible et maîtrisé. Je continue à scroller frénétiquement mais la question trotte dans ma tête : est-ce que vraiment, être boring est devenu désirable ? Et surtout, comment en est-on arrivé là ? Parce qu’il n’y a pas si longtemps, surtout après le Covid au Luxembourg comme ailleurs, tout le monde semblait aspirer à l’excès : fêtes, sorties, retrouvailles comme une urgence vitale. Et voilà qu’aujourd’hui, on célèbre la tisane, les soirées jeux (ça, je ne comprendrais jamais), les réveils aux aurores pour s’adonner à sa séance de Pilates et la sobriété.
C’est un fait : sur Instagram, je vois de plus en plus de récits de gens qui racontent leur bascule. Avant, ils sortaient beaucoup, buvaient trop, consommaient parfois certaines substances. Maintenant, ils affichent un quotidien plus rangé : sport, sommeil, alimentation saine. Ce qui n’était encore il y a quelques années seulement une question de santé, est désormais une identité. À ce propos, l’essor des boissons sans alcool – de la bulle chic de French Bloom (la marque co-créée par Constance Jablonksi) à la carte “no/low” des bars des capitales européennes – en dit long : on ose désormais dire qu’on ne boit plus, alors que pendant longtemps, l’alcool était le pendant social du cool.
La clean girl ou la sobriété comme identité
Sur ce chemin de pensée, je me suis ensuite arrêtée à un autre modèle érigé un standard sur les réseaux : celui de la clean girl. Cette fille bien sous tous rapports, cheveux tirés en bun, peau glowy, yoga au réveil, méditation avant de dormir. En apparence, rien de mal à ça. Mais derrière ce lifestyle lisse et parfait se cache tout de même un certain message politique. Parce que la clean girl, c’est bien celle qui ne fait pas de vagues : elle est lisse, ordonnée, impeccable. Bref, tout l’opposé de la messy girl, héritière des années 90 et de Kate Moss, désinvolte, excessive, désordonnée remise au goût du jour par le titre de Lola Young. La messy girl incarnait le trop, la provocation, l’imperfection. La clean girl impose le contraire : une esthétique sans aspérités, qui rassure et qui s’intègre parfaitement dans le flux d’Instagram.
Et si cette opposition résonne autant aujourd’hui, c’est que la messy girl fait elle aussi son retour, analysée récemment comme une tendance de fond. Elle revendique le droit de ne pas être parfaite : cheveux décoiffés, maquillage qui coule, look volontairement approximatif. Une esthétique de l’imperfection qui redonne une valeur de résistance au désordre assumé. La messy girl dit : je peux être séduisante en étant brouillon, bruyante, trop. Là où la clean girl incarne le consensus, elle incarne le vacarme. Deux visions du féminin qui ne cessent de se répondre, et dont le balancier culturel explique aussi, sûrement, pourquoi le boring est de nouveau perçu comme désirable.
Dès lors, la clean girl n’est pas seulement un style, elle incarne une norme implicite : ne pas déranger, ne pas troubler, ne pas exister trop fort
Et c’est là que le boring devient intéressant, voire inquiétant. Dès lors, la clean girl n’est pas seulement un style, elle incarne une norme implicite : ne pas déranger, ne pas troubler, ne pas exister trop fort. Dans un article du média canadien Urbania, la journaliste Audrey Boutin va jusqu’à dire que cette esthétique a des « relents fascistes ». L’expression peut choquer ; hélas elle touche juste. Car cette obsession du propre, du neutre, du discipliné n’est jamais innocente, elle hiérarchise. Elle valorise certains corps – jeunes, minces, souvent blancs – et en exclut d’autres. Ce qui se présente comme universel gomme en réalité la différence, le bruit, l’excès.
L’ascèse plus désirable que la fête
Ce besoin de rigueur, je le retrouve aussi ailleurs. Dans le sport, par exemple, où la discipline portée à l’extrême est devenue sexy. L’UTMB, 170 kilomètres autour du Mont-Blanc, fascine autant qu’un festival : des silhouettes harassées – ô combien sublimes – , des corps sculptés par l’endurance, une souffrance érigée en esthétique. La fête a perdu son prestige, c’est l’ascèse qui séduit. Même sur Instagram, les « strava kudos » se likent comme autrefois les selfies en club. Bref, la constance, la régularité, la sobriété sont devenues des trophées sociaux.
Il y a des figures qui incarnent cette tendance, de ces femmes aux routines cadrées, élégance maîtrisée, discipline devenue glamour. Ce qu’elles incarnent, ce n’est pas l’excès flamboyant, mais le contrôle. Et dans notre époque instable, ce contrôle fascine. Comme l’écrivait Pierre Bourdieu dans La Distinction : « Le goût est une marque de distinction. Il unit et sépare, il distingue. » Hier, c’était le champagne hors de prix ou les nuits blanches qui distinguaient. Aujourd’hui, c’est la capacité à dire non, à se contenir, à rester impeccable.
Le boring ou comment faire taire le bruit
Mais ce calme n’est pas accessible à tous. Derrière les brunchs feutrés, derrière les bulles raffinées désalcoolisées, derrière les dressings capsule du quiet luxury, il y a du capital. La sobriété coûte cher. Pouvoir refuser l’excès, c’est un privilège. Pouvoir afficher une vie parfaitement maîtrisée, c’est disposer de temps, d’argent, de sécurité. Le boring n’est pas une échappée démocratique, c’est une nouvelle distinction sociale. Une manière subtile de dire : « Je ne suis pas comme vous ». Et c’est là que le piège apparaît. Résolument, cette esthétique du boring trie, en valorisant le calme, la retenue, la discrétion. Elle invisibilise le bruit, le désordre, la différence. Aux États-Unis, des critiques de la clean girl ont montré qu’elle naturalise un idéal blanc, mince, lisse. Tout ce qui n’y correspond pas devient « trop ». C’est une violence douce : pas besoin d’interdire ou de censurer. Il suffit que ce modèle s’affiche comme le sommet du chic pour que tout le reste paraisse déplacé.
Alors oui, boring is the new cool, sûrement, et moi aussi, je préfère résolument les soirées passées à lire que les soirées qui finissent au petit matin (mais c’est aussi sûrement parce que j’ai plus de 40 ans). Mais, est-ce une révolution ? Je n’en suis pas si sûre. C’est peut-être une réorganisation. Après l’excès tapageur des années 2000, voici le règne de la retenue. Dans les deux cas, le mécanisme est le même : marquer qui est au-dessus, qui est capable de maîtriser, de se distinguer.
C’est vrai, le boring libère d’une certaine frénésie, il apaise. Mais il impose aussi un modèle silencieux, qui laisse peu de place au désordre dans un monde où on tente de plus en plus de cadenasser la parole, où le débat perd en vigueur dès lors qu’on s’oppose aux élites bien pensantes. Et je me demande si la vraie subversion, aujourd’hui, ne serait pas plutôt de revendiquer le bruit, l’imperfection, le trop. La liberté ne se trouve pas seulement dans la discipline. Elle existe aussi dans le droit d’être brouillon, visible, excessif.
À lire également
Situationship : la (dés)illusion des amours modernes
« La désirabilité est construite par nos politiques sexuelles » : qu’est-ce que la fuckability ?
Et si vous étiez dermorexique ?