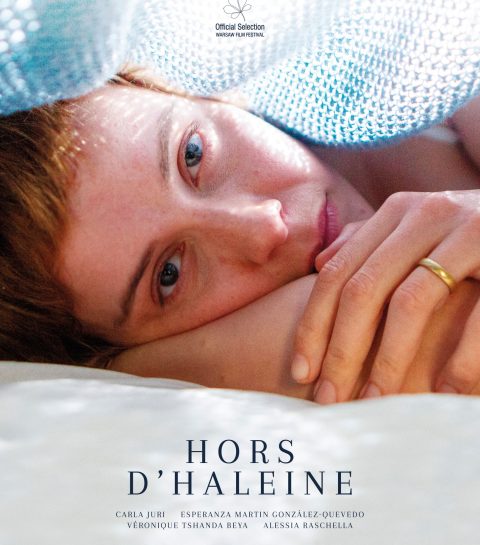Pour sa première exposition solo en Europe, présentée par la galerie Zidoun-Bossuyt dans le cadre de la 11e Luxembourg Art Week, YoYo Lander expose un ensemble d’œuvres qui condensent plus de dix ans de recherche sur le corps, sa présence, ses appuis, ses failles et sa lumière.
Lorsqu’elle accueille ELLE Luxembourg pour la visite de l’exposition, elle parle de gestes, de chutes de papier, de nuances de peau qu’elle fabrique elle-même, et d’instants précis où un modèle a cessé de jouer un rôle pour redevenir simplement lui-même.
Son rapport au corps trouve son origine dans un choc intime. Petite, elle observait son père après un accident de voiture qui l’a laissé presque paralysé, et surtout privé de parole pendant un temps. « On devait tout lire dans ses yeux », raconte-t-elle. Cette attention extrême au moindre mouvement, à la posture, à la façon dont un corps « existe » quand il ne peut plus s’exprimer autrement, est devenue la base de son œuvre. « Je ne prends jamais le mouvement pour acquis », dit-elle. « C’est un cadeau. »
La technique, cœur du propos
YoYo commence par « Lukewarm ». Le sujet, Vaughn, est quelqu’un qu’elle connaît vaguement et qui, dit-elle, « se cache très bien ». Ni extravertie ni timide : un état intermédiaire qu’elle voulait traduire. Le titre n’a rien d’anodin : « Ce que j’aime, c’est la force qu’il y a dans le milieu, dans l’entre-deux. On n’a pas besoin d’être extrême pour exister ». Elle explique que les poèmes ne sont pas systématiques ; ils s’imposent quand une figure en nécessite un, comme une sorte de ponctuation.
Dans Burdened by Blessings, elle développe un autre paradoxe : celui d’une gratitude lourde à porter. « On croit que les bénédictions devraient être faciles. Mais souvent, elles sont aussi un poids ». Elle montre une zone de couleur jaune, une teinte qu’elle déteste travailler, « trop capricieuse » : elle l’a finalement acceptée pour traduire cette tension entre joie et responsabilité.
Plus loin, elle s’arrête devant « « A Friend of Mine. « Je ne savais pas quoi en faire, puis je me suis dit : elle ressemble à quelqu’un qu’on connaît ». Comprenez, cette girl next door. L’idée lui importe : ses œuvres ne sont jamais des portraits psychologiques ou des effets spectaculaires. Elle ne cherche ni l’extrême ni le grotesque. « Je veux qu’on puisse se reconnaître. Pas s’identifier à une célébrité ou à une situation hors norme. Je veux peindre les gens comme ils sont dans leur temps seul ».
Le moment le plus fort de la visite est celui où elle raconte l’histoire derrière « I’ll Never Not Like Dandelions (the yellow ones) ». Le modèle, une femme qui a vécu plusieurs drames, et notamment la perte d’un enfant, lui inspire le parallèle avec les pissenlits : des fleurs qu’on méprise, mais qui reviennent toujours. « Sa résilience me rappelait cette force-là », dit-elle avant de lire un extrait du poème : « J’aime comment ils font la beauté de ‘tu ne devrais pas être ici’ ».
Même les choix techniques ont une histoire. Pour la première fois, elle a accepté la suggestion d’Audrey Bossuyt, sa galeriste, de travailler sur plutôt qu’entièrement sur papier. « J’avais peur du mélange des techniques », avoue-t-elle. « Mais je suis heureuse qu’on m’ait poussée. Je ne reviendrai probablement jamais en arrière ». Le collage sur toile lui permet une respiration différente : les couches se déplacent, absorbent la lumière autrement.
Sa méthode est méticuleuse : elle photographie 10 à 15 personnes par série, en gardant parfois jusqu’à 200 images par modèle. Elle attend ensuite « environ un mois » pour revenir dessus. Puis elle peint de grandes feuilles de papier aquarelle, dans toutes les nuances de peau imaginables : oranges, gris, jaunes de Naples, siennes, violets, beiges mélangés. « Je n’écris jamais mes mélanges », précise-t-elle. « Je préfère la liberté de l’inconnu ». Chaque œuvre demande environ trois semaines, jamais d’une traite : les poses, dit-elle, l’épuisent physiquement.
« Sweet and Rye » est peut-être la plus inattendue : le modèle est arrivée au studio partagée entre excitation et peur. Cette hésitation lui a rappelé un homme de sa communauté, surnommé Sweet and Rye, qui marquait son chemin en plaçant des branches sur la route — puis les retirait en rentrant chez lui. « Une métaphore de la vie : on laisse des repères, on nettoie derrière. On avance comme on peut ».
Enfin vient « This Can’t Be It » : YoYo lit le texte qui accompagne le portrait en entier : une réflexion sur la routine, l’usure, les attentes déçues, et la culpabilité d’avoir envie de plus. Une pensée « de milieu de vie », dit-elle en souriant. « J’ai voulu capturer le moment où on se demande : est-ce que c’est tout ? Et peut-être que oui. Peut-être que “ça”, c’est déjà une forme de courage ».
Luxembourg : lenteur, respiration, et liberté de faire autrement
Quand on lui demande ce que ce séjour au Luxembourg a changé, elle sourit : « Un certain sens de la quiétude ». Elle explique qu’à Los Angeles, tout va très vite, trop vite. Ici, au contraire, elle s’est surprise à marcher, à observer, à être attentive à des choses minuscules. « J’ai senti que je pouvais penser sans être interrompue par le monde ».
YoYo Lander répète tout au long de la visite que ses œuvres ne peuvent exister que parce qu’elle accepte leur lenteur. « Un tableau prend environ vingt et un jours », dit-elle. Pas d’un bloc : par séquences, avec des pauses nécessaires pour « laisser reposer le regard » et éviter la fatigue physique des longues heures de découpe.
Elle raconte d’ailleurs que certaines œuvres de l’exposition ont été terminées ici, non pas par manque de temps, mais parce qu’elle avait la place mentale pour reprendre un détail qu’elle aurait peut-être laissé passer ailleurs : une nuance de peau trop grise, un papier qui n’absorbait pas la lumière comme prévu, ou un œil qu’elle redoutait d’exécuter — « Si je me trompe sur les yeux, toute la pièce est fausse ».
À Luxembourg, elle a pu ralentir sans interrompre son élan. Un rythme qui l’a ramenée à ce qui fonde sa pratique : regarder longtemps avant de décider. « J’attends un mois avant de choisir les photos. J’ai besoin que l’image me revienne sans bruit autour ». C’est aussi ce qu’elle a retrouvé ici : la possibilité de laisser une œuvre ‘revenir’ à elle.
Cette attention au temps, à l’ajustement, au processus en couches, dit peut-être plus de son travail que n’importe quelle explication conceptuelle. Une manière d’être au travail : patiente, minutieuse, répétitive, exigeante, la seule, dit-elle, qui lui permette de rendre justice aux corps qu’elle peint.
L’exposition est à voir jusqu’au 17 janvier 2026, à la galerie Zidoun-Bossuyt, 6 rue Saint-Ulric, Luxembourg
À lire également
Que faire en décembre au Luxembourg ?
Violences faites aux femmes : ce que l’affaire Shaina révèle selon l’avocate Negar Haeri
Au Luxembourg, ces femmes qui collectionnent pour changer le monde